Quel avenir pour le métier d’assistante maternelle ?

Et si on écoutait enfin celles qui accueillent nos enfants chaque jour ?
Pourquoi parle-t-on de réforme sans leur donner la parole ? Pourquoi pense-t-on l’avenir de la petite enfance sans celles qui la vivent au quotidien ?
Alors que la natalité s’effondre, que les vocations s’amenuisent et que les règles changent sans cesse, des milliers d’assistantes maternelles continuent d’ouvrir leur porte chaque matin, parfois pour rien. Elles observent, s’adaptent, s’inquiètent. Et attendent qu’on les voie, qu’on les comprenne, qu’on les associe.
Ce dossier propose une analyse claire et concrète de la situation actuelle, des données à jour, et surtout des pistes de solutions réalistes à envisager, compléter, questionner. Il s’agit d’un point de départ, pas d’un programme fermé. Baisse des naissances, réforme du CMG, déséquilibres territoriaux, évolution du statut, reconnaissance des compétences : tout est passé au crible, et chacun peut enrichir cette réflexion par son expérience ou ses idées.
📌 Moins de naissances ne veut pas dire que les besoins disparaissent. Et sûrement pas que les professionnelles de la petite enfance doivent disparaître avec. Il est temps de regarder la réalité en face, et d’agir pour ne pas laisser sombrer un métier pilier de notre société.
Sommaire
📉 Baisse de la natalité en France : quelles conséquences pour les assistantes maternelles ?
La baisse de la natalité en France n’est plus une hypothèse : c’est un fait documenté, durable, et aux conséquences bien réelles pour le secteur de la petite enfance.
En 2023, la France a enregistré 678 000 naissances, soit le chiffre le plus bas depuis 1946. (source : INSEE, Bilan démographique 2023)
Le taux de fécondité est tombé à 1,68 enfant par femme, contre 2,02 en 2010.
Ce recul est à la fois lié à des changements de société (âge plus tardif du premier enfant, précarité économique, remise en question du modèle familial traditionnel) et à des facteurs structurels : le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants baisse mécaniquement depuis plusieurs années.
Selon l’INSEE, certaines zones verront d’ici 2030 une baisse de 2 à 4 % du nombre d’enfants de moins de 3 ans.
➡️ Cette baisse progressive du nombre de naissances, comme un entonnoir qui se resserre, réduit naturellement la demande d’accueil. Mais cette évolution ne touche pas tous les territoires de la même manière : certaines zones sont très impactées, d’autres beaucoup moins.
🗺️ Baisse de la natalité : un impact territorial inégal pour les assistantes maternelles
Et pourquoi pas commencer par regarder ce qui se passe, concrètement, sur le terrain ? Dans les zones rurales ou vieillissantes, les naissances chutent, les classes ferment, tout comme certaines structures d’accueil. À l’inverse, dans les grandes métropoles et les zones périurbaines attractives, la demande reste forte, parfois même insatisfaite.
👉 Ce n’est donc pas une simple crise de la natalité, mais un déséquilibre géographique profond. Certains territoires manquent de bras… d’autres ont plus de places que d’enfants. Résultat : des pros sans emploi d’un côté, et des familles sans solution de l’autre.
Ce décalage oblige à repenser l’organisation du métier à l’échelle locale. Une approche plus fine, ancrée dans le réel, basée sur des données à jour. Pour anticiper les besoins, ajuster les formations, mieux répartir les installations… et éviter le grand écart entre zones saturées et zones désertées.
➡️ Et pourquoi pas imaginer un Observatoire local de l’accueil du jeune enfant ? Un outil collectif (CAF, communes, France Travail, relais petite enfance…) pour suivre en temps réel les besoins en accueil sur chaque territoire. Cela permettrait aussi aux assmats de faire un mini audit local : observer les profils des familles accueillies, anticiper les effets des réformes (comme le nouveau CMG ou la baisse des naissances), et ajuster leur projet pro en fonction. Une boussole concrète, ancrée dans le quotidien, pour avancer avec plus de clarté… et plus d’impact.
👉 Pour mieux comprendre les effets du nouveau calcul, ses impacts sur les familles et les assmats, consultez l’article : Réforme du CMG 2025 : ce que ça change vraiment
⚠️ Pénurie d’assistantes maternelles : des départs massifs sans relève suffisante
En parallèle, le métier d’assistante maternelle traverse un véritable choc générationnel : chaque année, environ 12 000 professionnelles quittent le métier, et d’ici 2035, ce sont plus de 100 000 départs à la retraite qui sont attendus — soit près d’une assistante maternelle sur deux. Source DREES – Lassmat.fr
Et le problème, c’est que les nouvelles entrées ne suffisent plus à compenser ces départs. Les vocations se raréfient, le nombre de candidates à l’agrément ou à la formation reste trop bas… et parmi celles qui se lancent, une partie quitte le métier rapidement. Le manque d’accompagnement, l’isolement et l’écart entre les attentes et la réalité du terrain expliquent en grande partie ces arrêts précoces.
Ce déséquilibre crée un vide inquiétant dans certains territoires, tout en accentuant la concurrence dans d’autres. À la clé : un sous-emploi déguisé, des démissions silencieuses, et une instabilité croissante qui fragilise la profession dans son ensemble.
🔍 Ce double mouvement (moins d’enfants, moins de professionnelles) crée un paradoxe : certaines zones sont saturées d’assistantes maternelles sans demandes… pendant que d’autres n’ont plus personne pour accueillir.
💡 Et pourquoi pas se pencher de plus près sur ce qui se passe localement ? Car les besoins ne sont pas les mêmes partout, et c’est en regardant de près ce qui se passe sur chaque territoire qu’on peut vraiment agir. Dans les zones où la demande reste forte, il est possible de soutenir les projets d’installation. Et ailleurs, là où c’est plus compliqué, d’autres idées peuvent émerger : aider à la reconversion, favoriser le travail en binôme ou en petit collectif, élargir les missions… Bref, imaginer des solutions qui collent à la réalité du terrain. Une approche souple, au cas par cas, bien plus efficace qu’une grande mesure uniforme qui ne parlerait à personne.
Ce phénomène de départs massifs soulève aussi des questions très concrètes pour les familles comme pour les professionnelles. Ce guide complet sur la fin de contrat avec une assistante maternelle permet de mieux comprendre les démarches, les droits de chacune, et les conséquences sur l’organisation de l’accueil.
👶 Baisse de la natalité : quelles conséquences pour les assistantes maternelles ?
Sur le terrain, ces évolutions se traduisent par des situations très concrètes pour les professionnelles de l’accueil :
Une concurrence accrue : dans certaines zones, les annonces ressemblent à de véritables appels d’offres, où les familles choisissent entre plusieurs assistantes maternelles disponibles.
Une augmentation des petits contrats non choisis : les journées sont souvent morcelées, les horaires changent tout le temps, les plannings ne tiennent plus sur la durée… et cela rend l’organisation difficile au quotidien.
Un sous-emploi déguisé : beaucoup accueillent moins d’enfants que ce que leur agrément permettrait, tout simplement parce qu’il n’y a pas assez de demandes autour d’elles.
Une perte de repères professionnelle : ce climat provoque du découragement, pousse certaines à changer de métier, et entraîne ce qu’on pourrait appeler des démissions silencieuses : des professionnelles qui décrochent petit à petit, sans arrêt officiel, sans accompagnement, juste parce que le quotidien perd peu à peu sa cohérence.
Certaines nouvelles assistantes maternelles arrêtent après quelques mois seulement, parce qu’elles manquent de demandes, de visibilité ou de soutien. Et du côté des anciennes, beaucoup se sentent perdues : elles aiment toujours leur métier, mais ont du mal à retrouver du sens face à un quotidien qui change trop vite.
🧭 Tous ces petits signes en apparence discrets montrent en réalité qu’un vrai malaise s’installe. Il est parfois difficile à voir, mais il est bel et bien là, sur le terrain, au quotidien.
🧱 Assistantes maternelles : des inégalités entre générations et territoires
Un écart se creuse petit à petit entre celles qui exercent depuis longtemps et celles qui débutent. Les nouvelles assistantes maternelles suivent une formation plus structurée, avec des attentes précises. De leur côté, les plus anciennes ont souvent l’impression que leur expérience n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur, comme si leur vécu comptait moins que les diplômes. Résultat : deux visions qui cohabitent parfois difficilement, avec des repères différents… et une certaine incompréhension qui s’installe.
Selon les départements, les règles fixées par les PMI peuvent être très différentes. Certaines imposent des conditions bien plus strictes que ce que prévoit le référentiel national, tandis que d’autres sont beaucoup plus souples. Résultat : une assistante maternelle peut être agréée dans une région… mais refusée dans une autre pour la même situation. Cette inégalité crée de la confusion, et un vrai sentiment d’injustice chez beaucoup.
Ce sentiment s’accentue avec le temps. Une assistante maternelle qui débute aujourd’hui ne se retrouve pas forcément dans les mêmes conditions que celle qui exerce depuis vingt ans. Les formations ont évolué, les attentes aussi, et tout dépend du lieu d’exercice et du moment d’entrée dans le métier. Certaines doivent répondre à des exigences plus élevées, d’autres non. Tout cela entretient une impression d’arbitraire, et renforce l’idée d’un système mal coordonné.
🔍 Revaloriser le métier d’assistante maternelle : 8 pistes pour agir concrètement
Et si on ouvrait quelques pistes de réflexion, simplement, pour que ce métier retrouve un peu de clarté, d’équilibre… et toute sa place dans la vie des familles ?
✅ 1. Harmoniser les pratiques entre PMI
Malgré l’existence d’un référentiel national censé donner une base commune, les règles changent encore beaucoup d’un département à l’autre. Dans certains endroits, les lits pliants sont autorisés ; ailleurs, ils sont interdits. Certaines PMI refusent un agrément si des animaux vivent dans le logement, d’autres n’y voient aucun problème. Il arrive aussi qu’on exige une chambre par enfant accueilli, ce qui exclut de fait beaucoup de logements pourtant adaptés. Les critères varient aussi selon la taille du logement, la présence d’un étage, ou les horaires proposés. Tout cela crée de l’incompréhension, car ce qui est accepté ici peut être refusé ailleurs sans explication.
👉 Et si chaque personne qui souhaite devenir assistante maternelle recevait dès le début un document simple, clair, identique pour toute la France, qui explique ce qu’on attend vraiment pour obtenir son agrément ? Malgré le référentiel national, chaque PMI fixe encore ses propres règles, ce qui crée beaucoup de flou. Ce livret, remis avant toute visite de la PMI, permettrait d’avoir une base commune, des repères concrets, et surtout des exigences que chaque département serait tenu de respecter. Un outil pour se préparer sereinement, sans découvertes de dernière minute, et commencer ce métier avec confiance, sans stress inutile ni contradiction selon l’endroit où l’on habite.
✅ 2. Mieux cartographier les besoins en temps réel
Mettre en place un observatoire local de l’accueil du jeune enfant, un outil partagé entre la CAF, les communes, France Travail et les relais petite enfance, qui permettrait de suivre en temps réel la situation dans chaque territoire : où il manque des professionnelles, où l’offre est trop importante, quelles sont les évolutions à venir. Cet observatoire aiderait à mieux anticiper, mieux répartir, mieux accompagner. Une sorte de boussole concrète pour que chacun puisse adapter son projet ou ses choix à la réalité du terrain.
🎯 Objectif : permettre aux futures assistantes maternelles de savoir facilement, grâce à une carte ou un tableau clair, si la zone où elles souhaitent exercer est déjà bien pourvue ou non. Cette information, partagée lors des rendez-vous en PMI ou par les relais petite enfance, aiderait à mieux répartir les installations, à orienter les formations, et à éviter que certaines zones soient saturées pendant que d’autres restent à découvert. Cela pourrait aussi être un point de discussion dès les premiers échanges avec les services concernés, pour ajuster les projets en connaissance de cause, sans créer de faux espoirs ni fermer des portes inutilement.
✅ 3. Accompagner la mobilité géographique
Mettre en place un fonds d’aide à la mobilité pourrait vraiment changer la donne. L’idée ? Proposer un accompagnement concret pour celles qui accepteraient de s’installer dans des zones où il manque cruellement d’assistantes maternelles. Cela pourrait passer par une prime de déménagement, une aide au logement, ou un partenariat avec les communes pour trouver un hébergement.
Mais soyons réalistes : la plupart des assistantes maternelles exercent chez elles, avec leur famille. Difficile de tout quitter sans contrepartie solide. Il faudrait donc que cette aide soit vraiment incitative : prise en charge d’une partie du loyer, soutien pour inscrire les enfants à l’école, accompagnement administratif, voire même une garantie de démarrage avec des contrats à la clé. Bref, un vrai coup de pouce pour que cette mobilité ne soit pas un sacrifice… mais une opportunité.
👉 Certaines zones rurales manquent cruellement d’assistantes maternelles… pendant que d’autres sont saturées.
✅ 4. Développer des missions complémentaires
L’assistante maternelle peut aussi envisager d’élargir ses missions en fonction des besoins réels des familles autour d’elle. Voici quelques pistes concrètes :
Proposer un accueil périscolaire pour les enfants de 4 à 11 ans, avant ou après l’école, les mercredis ou pendant les vacances. Certaines assmats le font déjà, souvent discrètement, par bouche-à-oreille ou par habitude. Il serait utile d’en parler davantage, d’expliquer que c’est possible, que ça existe, que c’est encadré. Et pourquoi pas, à terme, proposer des aides pour le mettre en place : matériel adapté, valorisation dans le contrat, soutien des collectivités ?
Être disponible ponctuellement sur des horaires particuliers : en soirée, très tôt le matin ou les week-ends, pour aider les parents qui travaillent en horaires décalés. Cela ne concerne pas toutes les professionnelles, mais certaines y trouvent un équilibre. Un accompagnement ou une reconnaissance spécifique pourrait encourager ces démarches.
Organiser des petits ateliers d’éveil ouverts aux enfants accompagnés d’un parent en congé parental : comptines, peinture, jeux sensoriels… Cela valorise les compétences de l’assistante maternelle tout en créant du lien social. Une petite aide logistique (espace, matériel, communication) pourrait lever les freins.
Participer à des actions de soutien à la parentalité (cafés-rencontres, groupes de parole, animations en lien avec un relais ou une mairie). Cela se fait déjà ici ou là, mais manque souvent de visibilité ou de cadre clair. En structurant un peu mieux ces initiatives, on pourrait encourager plus de professionnelles à s’impliquer.
👉 Moins d’enfants ne signifie pas moins de besoins. Cela suppose simplement de redessiner les contours du métier, d’envisager des passerelles, et de proposer des solutions concrètes en phase avec les réalités des familles.
✅ 5. Créer de vraies passerelles professionnelles
Certaines assistantes maternelles souhaitent évoluer, mais ne savent pas comment :
Certaines assistantes maternelles, après plusieurs années d’exercice, souhaitent évoluer sans forcément quitter le secteur de la petite enfance. Une reconversion peut alors prendre plusieurs formes : travailler en crèche (publique ou privée), intégrer un relais petite enfance en tant qu’animatrice ou référente, ou encore se tourner vers la formation professionnelle pour transmettre leur expérience. Ces passerelles sont précieuses mais encore trop peu visibles. Il serait utile de les structurer, de les valoriser, et d’en faire de véritables voies de progression, accessibles avec des formations complémentaires courtes, des validations d’acquis ou des accompagnements à la transition. Une manière de ne pas perdre l’expertise du terrain… et d’offrir de nouvelles perspectives à celles qui souhaitent changer de cadre tout en restant proches des enfants.
Devenir tutrice, formatrice, coordinatrice ? Ces rôles sont encore peu connus mais représentent de véritables opportunités pour prolonger l’engagement professionnel autrement. Par exemple, une assistante maternelle expérimentée peut devenir tutrice et accompagner les nouvelles dans leurs premiers pas, en partageant ses savoir-faire et en facilitant leur insertion. Elle peut aussi se former pour animer des modules dans le cadre des formations initiales ou continues, que ce soit en partenariat avec des centres de formation, des relais petite enfance ou des organismes spécialisés. Quant au poste de coordinatrice (en crèche, en relais), il demande des compétences en gestion, en animation d’équipe, et en pilotage de projets : autant de compétences que certaines professionnelles ont déjà développées sur le terrain, sans reconnaissance formelle. Il serait donc pertinent de créer des passerelles plus fluides, des formations adaptées, et une vraie reconnaissance de ces fonctions de transmission, de coordination et d’expertise.?
👉 Il faut créer des ponts visibles, lisibles, valorisés. Cela signifie mettre en place de véritables itinéraires professionnels, clairs et accessibles, pour permettre aux assistantes maternelles d’évoluer sans avoir à repartir de zéro. Des plaquettes d’information simples, des interlocuteurs identifiés dans chaque relais petite enfance, des dispositifs de financement pour les formations complémentaires, des passerelles validées entre les métiers de terrain et les postes d’encadrement ou de formation : voilà ce qui manque aujourd’hui. Ces passerelles devraient être visibles dès l’entrée dans le métier, comme une promesse d’évolution possible, et non comme une porte étroite réservée à quelques élues. Créer ces ponts, c’est aussi éviter la fuite des talents, et renforcer la profession dans son ensemble en valorisant l’expérience acquise au quotidien.
✅ 6. Une formation initiale cohérente et reconnue
La formation obligatoire actuelle est à la fois longue, dense et exigeante. Elle garantit un socle de compétences solide, en lien avec les réalités de terrain. Pourtant, certaines incohérences demeurent et fragilisent sa lisibilité.
Le renouvellement de l’agrément ne repose pas sur la réussite au CAP AEPE dans son intégralité, mais uniquement sur la présentation à deux épreuves spécifiques : l’EP1 (prise en charge de l’enfant à domicile) et l’EP3 (techniques de service à l’usager). Il suffit de se présenter à ces épreuves, sans obligation d’obtenir la moyenne. En pratique, tant que l’assistante maternelle s’est rendue aux épreuves, elle peut être renouvelée. Si elle obtient la moyenne, son agrément est renouvelé pour 10 ans (encore faut-il que la PMI applique cette règle, ce qui n’est pas systématique). Si elle n’a pas la moyenne, elle est tout de même renouvelée… pour 5 ans.
Autrement dit, une professionnelle peut continuer à exercer même sans avoir validé les compétences de base attendues. Cette situation crée un flou inquiétant : d’un côté, aucune reconnaissance particulière pour celles qui valident avec succès ; de l’autre, une poursuite possible sans validation réelle.
👉 Il serait pertinent de proposer une formation complémentaire approfondie pour les assistantes maternelles n’ayant pas obtenu la moyenne, afin de leur permettre de consolider leurs acquis, combler les lacunes, et exercer avec davantage de sécurité et de confiance. Cette formation pourrait être obligatoire avant le second renouvellement, et valorisée comme une montée en compétence réelle. Cela garantirait un niveau commun minimal, tout en offrant un accompagnement constructif plutôt qu’un simple couperet.
Valoriser les assmats déjà diplômées
Un grand nombre d’assistantes maternelles entrent dans le métier avec un diplôme en poche : CAP Petite Enfance (ou AEPE), diplôme d’auxiliaire de puériculture, voire parfois un bac pro ASSP ou une VAE. Pourtant, ces qualifications sont rarement prises en compte dans leur reconnaissance statutaire, leur rémunération ou leur parcours professionnel.
👉 Il est essentiel de mettre en place des passerelles automatiques et des avantages concrets pour les assistantes maternelles diplômées, comme :
Une validation directe de certaines étapes de formation obligatoire, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour certaines titulaires de diplômes, mais qui mériterait d’être généralisée, harmonisée entre les départements, et élargie à d’autres profils qualifiés. Cela permettrait de garantir une reconnaissance équitable des parcours antérieurs, en évitant que des assistantes maternelles diplômées aient à suivre des modules déjà maîtrisés, parfois sans lien avec leurs compétences acquises. Une clarification nationale et systématique de ces dispenses permettrait de mieux valoriser les qualifications existantes… et de gagner en cohérence.
Une prime d’entrée dans le métier ou une bonification du montant horaire minimum pour les professionnelles qualifiées. Aujourd’hui, certaines mesures existent déjà, notamment pour les titulaires du titre « Assistant maternel / Garde d’enfants » (certification RNCP niveau 3). Mais ces dispositifs devraient être élargis à toutes les professionnelles justifiant d’un diplôme dans la petite enfance : CAP AEPE, auxiliaire de puériculture, bac pro ASSP, etc. Cette reconnaissance élargie permettrait de valoriser l’ensemble des parcours qualifiants, en évitant les effets de seuil ou d’exclusion injustifiés. Cela suppose d’unifier les critères au niveau national et de faire évoluer les référentiels pour que chaque diplôme utile au métier d’assistante maternelle ouvre droit à des avantages concrets : dispense de formation redondante, rémunération revalorisée, accès facilité à des fonctions de tutorat ou de spécialisation.
Une valorisation dans les référencements officiels (CAF, Monenfant.fr, communes), afin que les parents identifient facilement les profils expérimentés.
Une accès facilité aux fonctions de tutrice ou de formatrice, sans avoir à tout recommencer à zéro.
📌 Ces mesures permettraient non seulement de reconnaître la valeur de l’expérience antérieure, mais aussi d’attirer dans le métier des profils déjà formés, ce qui est essentiel dans un contexte de raréfaction des vocations.
✅ 7. Reconnaître pleinement les assistantes maternelles dans les politiques publiques
Les assistantes maternelles sont les grandes absentes des campagnes de communication nationale. Elles restent largement invisibles dans les débats publics, oubliées dans les priorités politiques locales, malgré leur rôle fondamental dans l’accueil du jeune enfant.
Cette invisibilité est souvent nourrie par des stéréotypes tenaces. Cet article sur les clichés autour des assistantes maternelles aide à comprendre ces idées reçues et montre le vrai visage de leur métier.
Le cas du droit opposable à un mode de garde
Le 21 juillet 2025, Gabriel Attal a proposé un droit opposable à la garde d’enfants : si une commune ne propose pas de solution, la CAF devrait en fournir une, avec des mécanismes de sanction pour les collectivités défaillantes.
👉 Sur le papier, cela répond à une urgence réelle. Mais dans les faits, ce projet :
Se concentre quasi exclusivement sur les crèches.
Oublie l’accueil individuel dans la formulation et dans la mise en œuvre.
Pourtant, ce sont souvent les assistantes maternelles qui assurent les horaires atypiques, les accueils d’urgence, les parcours complexes. Sans elles, aucun système ne tiendra.
➡️ Il est donc essentiel d’intégrer les assistantes maternelles dans les outils de coordination locale, pour qu’elles soient pleinement reconnues dans l’organisation de l’accueil des jeunes enfants sur chaque territoire.
Et les concerner dans les décisions ?
Pour que cette reconnaissance soit réelle et pas seulement symbolique, il faut aussi intégrer les assistantes maternelles dans les débats et les décisions qui les concernent. Cela peut passer par plusieurs leviers concrets :
Associer les assistantes maternelles aux concertations locales, en leur réservant une place dans les comités de pilotage, les groupes de travail autour de l’accueil du jeune enfant, les instances de coordination petite enfance mises en place dans les territoires.
Créer des consultations dédiées, à l’échelle nationale et départementale, où elles pourraient faire remonter leurs réalités, leurs besoins et leurs propositions. Ces consultations pourraient être portées par les relais petite enfance, les départements ou les CAF.
Encourager la représentation professionnelle, en soutenant les collectifs ou réseaux existants (syndicats, associations, plateformes locales), et en facilitant leur participation à la construction des politiques publiques.
Faire évoluer les outils de pilotage, comme Monenfant.fr ou les observatoires territoriaux, pour qu’ils intègrent l’avis des professionnelles de l’accueil individuel.
🎯 L’enjeu est simple : ne plus parler des assistantes maternelles sans elles. Les écouter, les associer, leur donner les moyens de contribuer. Car ce sont elles qui vivent le terrain. Et sans leur regard, aucune réforme ne tiendra dans la durée.
Pour aller plus loin, cet article sur le référentiel qualité petite enfance 2025 détaille les grands axes et propose des exemples concrets pour mieux reconnaître, accompagner et valoriser le travail des assistantes maternelles.
🏛️ Ce qu’une commune peut mettre en place concrètement
✅ 1. Créer ou relancer un comité local de l’accueil du jeune enfant
Associer les assistantes maternelles aux réflexions territoriales : diagnostics partagés, besoins à venir, projets de coéducation, évolution du tissu familial… Cela permet d’anticiper et d’adapter les actions concrètes.
✅ 2. Soutenir la visibilité des assmats locales
Mettre à jour et diffuser la liste des assistantes maternelles disponibles via le site de la mairie, les écoles, les crèches.
Organiser une “journée portes ouvertes petite enfance” avec relais petite enfance et assistantes maternelles volontaires.
Créer une rubrique dédiée sur le site communal : profils, disponibilités, conseils aux familles.
✅ 3. Proposer un local partagé ou une maison de l’accueil
Mettre à disposition un lieu modulable pour accueillir des petits groupes avec plusieurs assmats (type mini-MAM municipale), animer des temps collectifs, ou organiser des ateliers parents/enfants.
✅ 4. Aider au démarrage ou à la relocalisation
Offrir un soutien logistique (ex. : logement temporaire adapté), financier (prime d’installation en zone prioritaire) ou administratif (aide à la création de MAM ou accompagnement de projets atypiques).
✅ 5. Créer une bourse locale des besoins
Recueillir les demandes des familles, centraliser les besoins ponctuels (horaires décalés, enfants en situation de handicap, accueil périscolaire…) et mettre en lien avec les professionnelles disponibles.
✅ 6. Faciliter l’accès à la formation continue
En lien avec les relais petite enfance et les organismes de formation, proposer des temps de formation sur site ou cofinancés par la collectivité (gestion des émotions, neurosciences, outils pédagogiques…).
✅ 7. Porter un message politique fort
Faire figurer l’accueil individuel dans le projet éducatif de territoire (PEDT), le plan enfance municipal, ou la communication de la commune. Valoriser les assistantes maternelles comme partie intégrante du service public de proximité.
✅ 8. Mieux protéger les assistantes maternelles contre les impayés et clarifier leur statut
Un autre enjeu majeur reste trop souvent ignoré : la précarité administrative et financière liée aux impayés, aux litiges, ou à la mauvaise gestion des contrats. Trop d’assistantes maternelles se retrouvent à devoir réclamer leur dû, parfois des mois après la fin d’un contrat, sans garantie de résultat. Cela engendre du stress, une perte de revenus et une méfiance croissante vis-à-vis du statut.
👉 Il pourrait être pertinent de repenser une partie du modèle. Une piste ?
Confier à un organisme tiers (CAF, Urssaf ou autre service dédié) le rôle de tiers payeur : les familles verseraient leur part directement à l’organisme, qui reverserait ensuite à l’assistante maternelle l’ensemble du salaire (part publique + part parentale), de manière automatisée, transparente, et sécurisée. Ce système limiterait les retards et les impayés, fiabiliserait les revenus et permettrait aux professionnelles de se concentrer sur l’accueil plutôt que sur la paperasse ou les relances. Ce système, déjà partiellement amorcé avec Pajemploi +, pourrait être généralisé et renforcé pour couvrir l’ensemble des contrats d’accueil et garantir un paiement régulier même en cas d’erreur ou de retard de la part des parents.
🔐 Verrouillage temporaire en cas d’impayé : une mesure de bon sens
Actuellement, lorsqu’un parent met fin à un contrat sans régler les sommes dues (indemnités de fin, congés, régularisation d’heures…), aucun dispositif ne l’empêche d’engager immédiatement une nouvelle assistante maternelle ailleurs, sans rien régulariser. Ce flou crée un sentiment d’impunité, et une insécurité juridique pour les professionnelles concernées.
👉 Pour éviter que certaines familles multiplient les situations litigieuses sans conséquences, une mesure simple pourrait être mise en place :
🛑 Interdiction temporaire de signer un nouveau contrat via le portail MonEnfant.fr ou Pajemploi+ tant qu’un litige pour impayé est en cours.
Comment ça fonctionnerait ?
Lorsqu’un impayé est constaté et signalé via l’organisme tiers (CAF, Urssaf, ou autre structure habilitée), une relance officielle serait envoyée à la famille avec un délai de régularisation.
Sans résolution dans les délais, le dossier serait marqué comme « litigieux » dans le système centralisé.
Cela entraînerait automatiquement un blocage administratif empêchant la signature de nouveaux contrats via les canaux officiels (comme Pajemploi).
Dès la régularisation du solde dû (ou après médiation), le verrou serait levé, permettant de reprendre des démarches normales.
Cela permettrait :
- Responsabiliser les familles dans la gestion de leurs obligations contractuelles.
- Offrir aux professionnelles une garantie morale et administrative.
- Éviter la reproduction en série de comportements irrespectueux ou frauduleux.
Ce système ne viserait pas à punir mais à prévenir les abus, en rendant visible et encadrée une situation qui, aujourd’hui, repose uniquement sur la bonne foi. En responsabilisant tous les acteurs du contrat, on renforce la confiance, la justice et la sécurité du secteur.
Mettre en place un accompagnement juridique simplifié, avec des médiateurs départementaux ou des référents relais pour aider en cas de litige.
🎯 Objectif : décharger les assistantes maternelles de la gestion administrative complexe, sécuriser les paiements, et renforcer l’attractivité du métier.
👉 Il est temps d’explorer un nouveau statut ou au moins, des outils concrets pour garantir que l’engagement professionnel ne se transforme pas en insécurité financière.
🧭 En conclusion
Cette liste est évidemment loin d’être exhaustive. D’autres idées peuvent (et doivent) émerger, et les premières concernées sont les mieux placées pour enrichir la réflexion : les assistantes maternelles elles-mêmes.
Si d’autres pistes vous viennent en tête pour améliorer concrètement le quotidien, renforcer l’attractivité du métier ou faire bouger les lignes, n’hésitez pas à les partager en commentaire. Chaque retour compte. Chaque voix peut contribuer à faire évoluer les choses.
Et si cet article vous parle, n’hésitez pas à le partager autour de vous, dans vos réseaux, vos groupes, vos communes. Plus il circulera, plus les décideurs seront contraints de voir ce que vivent vraiment les assistantes maternelles. C’est ensemble que ce métier pourra (enfin) être entendu.
Le métier d’assistante maternelle traverse une zone de turbulence. Et pourtant, il reste plus que jamais un maillon essentiel du quotidien des familles.
Des réponses à vos questions
FAQ
❓Quel est l’impact de la baisse de la natalité sur le métier d’assistante maternelle ?
➡️ La diminution du nombre de naissances entraîne une baisse de la demande d’accueil, créant une situation de sous-emploi pour de nombreuses assistantes maternelles, surtout dans les zones rurales ou vieillissantes
❓Pourquoi certaines assistantes maternelles peinent elles à remplir leur agrément ?
➡️ Les déséquilibres territoriaux, les horaires atypiques non couverts et la concurrence entre professionnelles expliquent pourquoi certaines assistantes maternelles n’accueillent pas autant d’enfants que leur agrément le permet.
❓ Comment devenir tutrice ou formatrice en tant qu’assistante maternelle ?
➡️ Il est possible d’évoluer vers des rôles de tutrice, formatrice ou coordinatrice petite enfance en valorisant son expérience, via la VAE ou des formations complémentaires. Ces passerelles devraient être mieux structurées.
❓Que propose la réforme du CMG 2025 pour les assistantes maternelles ?
➡️ La réforme revoit les plafonds et les aides accordées aux familles, avec des effets indirects sur les assmats, notamment pour les petits contrats ou les accueils partagés. Un article détaillé est disponible sur ce sujet.
❓Les assistantes maternelles peuvent-elles faire de l’accueil périscolaire ?
➡️ Oui, l’accueil périscolaire est autorisé dans le cadre de l’agrément, sous réserve de conditions adaptées. Il constitue une diversification intéressante, notamment en cas de baisse des tout-petits.
❓Pourquoi harmoniser les pratiques des PMI ?
➡️ Parce que les exigences (logement, lits, animaux…) varient fortement d’un département à l’autre. Une harmonisation garantirait plus d’équité et de lisibilité dès l’agrément.
❓Peut-on sécuriser les paiements des assistantes maternelles ?
➡️ Des pistes existent : tiers payeur généralisé, verrou administratif en cas d’impayé, accompagnement juridique. Objectif : éviter que les assistantes maternelles ne subissent seules les litiges.
❓Quels sont les diplômes valorisables pour devenir assistante maternelle ?
➡️ Le CAP AEPE, le bac pro ASSP, le diplôme d’auxiliaire de puériculture, ou le titre professionnel d’assistant maternel/garde d’enfants permettent des dispenses ou une reconnaissance partielle. Mais cette valorisation reste à harmoniser.
❓Pourquoi mettre en place un observatoire local de l’accueil ?
➡️ Un observatoire permettrait de suivre les besoins réels des familles, d’éviter les zones saturées ou désertées, et d’orienter les projets professionnels des assistantes maternelles de manière plus réaliste.
❓Comment faire entendre sa voix en tant qu’assistante maternelle ?
➡️ Participer aux consultations locales, s’impliquer dans des collectifs, commenter les articles, partager ses idées, ou écrire à ses élus : chaque geste compte pour faire évoluer les politiques d’accueil.


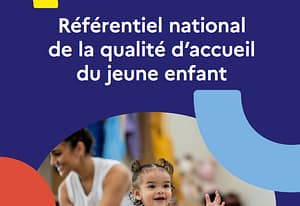


3 commentaires
Bonjour. Je suis assistante maternelle en Mam et je suis aussi à l’origine d une pétition afin de créer un statut d Ass mat remplaçante en Mam. Je pense que ce statut serait bien afin de ne plus « angoisser » de tomber malade, se casser une jambe ou autre et du coup de laisser des parents dans l embarra et d avoir la crainte de notre côté de « perdre » le contrat. Voici le lien de la pétition :
https://chng.it/ZwPzYLHKqJ
Merci à vous.
Il faut que l’on se mobilise pour faire avancer les choses !
Merci beaucoup pour votre message et pour cette initiative.
Ce type de proposition mérite clairement d’être porté, surtout en MAM, où l’absence d’une professionnelle peut vite tout désorganiser.
Il semble en effet essentiel de pouvoir être malade ou faire face à un imprévu sans craindre de perdre un contrat ou de laisser les familles démunies.
Merci d’avoir pris le temps de partager cette piste concrète ici. C’est exactement ce genre de réflexion qu’il faut faire circuler si l’on veut faire évoluer les choses.
Bonjour ici j’ai le cap petite enfance et pour mon 1 er renouvellement vous savez quoi je dois me présenter aux épreuves ep1 et ep3 du nouveau cap AEPE. Donc mon cap petite enfance ne me sert plus à rien ? Et donc c’est comme ça dans le 76 mais pas dans d’autre département c’est une injustice !!!!! Je n’ai pas envie de repasse ce diplôme c’est péjoratif pour moi . Cela ne m’apportera rien . Bonne journée